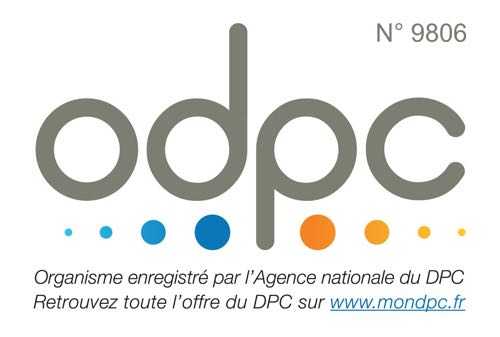Démarche diagnostique devant une anomalie de la natrémie en médecine générale (une heure)
Si vous êtes déjà inscrit, tapez juste votre adresse email puis votre mot de passe
Épisode 1 : Rappels physiopathologiques
La phrase du jour
« En dehors des troubles neurologiques, pas d’urgence à la correction : prenez le temps de comprendre la situation »
En dehors des troubles neurologiques, pas d’urgence à la correction : prenez le temps de comprendre la situation.
Nous allons voir dans ce 1er épisode les bases physiologiques à connaître pour pouvoir raisonner devant une dysnatrémie.
Le raisonnement devant un trouble de la natrémie peut parfois paraître complexe et beaucoup de médecins ou d’étudiants en médecine se sont déjà dit : «sujet trop complexe, du ressort des néphrologues ou des réanimateurs ». Les troubles de la natrémie sont pourtant fréquents, surtout les hyponatrémies, et concernent tous les médecins (généralistes, gériatres, cardiologues, néphrologues, endocrinologues, internistes, réanimateurs, urgentistes…)
En réalité, ces chapitres sont souvent mal traités dans les manuels de médecine et le temps qui leur est consacré dans la formation médicale est souvent trop court, avec trop peu de cas cliniques ou de mises en situations pratiques…
👉🏻Nous allons donc essayer de changer ces choses de façon modeste à notre échelle à travers ce DPC en vous donnant les clés pour mieux gérer les dysnatrémies.
En fait, pour bien gérer, on pourrait dire qu’il faut:
- comprendre le mécanisme
- pour agir afin de les corriger.
Pour cela, il faut connaître certains postulats de départ et certaines formules simplifiées.
Donc, en réalité, le raisonnement est assez simple et avec peu d’examens complémentaires et un peu de réflexion, on parvient rapidement au bon diagnostic et à la bonne prise en charge thérapeutique. Alors mettez vos ceintures, nous décollons pour un survol des troubles de la natrémie ! 🚀 🚀 🚀 🚀
Nous allons commencer par 3 postulats de départ à connaître par coeur :
- La natrémie est le reflet de l’osmolarité plasmatique qui régule les mouvements d’eau de part et d’autre des cellules.
- L’osmolarité de part et d’autre des cellules doit être égale.
- Les modifications d’osmolarité à travers les cellules se font par des mouvements d’eau et non d’osmoles.
Le postulat 2 c’est en fait le principe de Le Chatelier en chimie qu’on a tous appris au lycée ou en P1 :
«Si on tend à modifier les conditions d'un système en équilibre, il réagit de façon à s'opposer partiellement aux changements qu'on lui impose jusqu'à l'établissement d'un nouvel état d’équilibre.»
Autrement dit « Tu m’en donnes, j’en veux pas donc j’en consomme ». Il faut juste retenir que le système ici est l’osmolarité de part et d’autre des cellules et que l’opposition aux changements se fera par des mouvements d’eau !
Exemple :
Tu me donnes de l’eau dans le plasma (hypo-osmolarité), je ne veux pas modifier mon équilibre donc j’en transfère dans la cellule ainsi, hypo-osmolarité = hyper-hydratation cellulaire.
Voilà si vous avez compris cela : le cours est fini 😉
Pour les autres, on continue :
A partir de ces 3 postulats, vous pouvez donc déjà raisonner :
Je reprends l’exemple, s’il y a une hyponatrémie :
👉🏻 cela veut dire qu’il y a probablement hypo-osmolarité d’après le postulat 1,
👉🏻 comme on parle de concentration, cela revient à dire qu’il y a trop d’eau dans le plasma,
👉🏻 donc cela veut dire que l’organisme va créer un mouvement d’eau du plasma vers la cellule engendrant une hyper hydratation cellulaire d’après le postulat 2 et 3.
Nos cellules se comportent comme une éponge, capable de se gonfler d’eau (quand la pression osmotique baisse autour de la cellule) ou au contraire de se dégonfler (quand la pression osmotique augmente autour de la cellule). 2 remarques 💎 💎 💎 :
Vous avez lu : « s’il y a une hyponatrémie c’est probablement qu’il y a une hypo osmolarité » 👉🏻 pourquoi cette précaution de langage : « probablement »
Pour expliquer cette précaution de langage, il faut connaitre une équation en plus des 3 postulats de départ:
Osmolarité = 2*{Natrémie} + glycémie
Si dans le système de l’équation ci-dessus, on met du sucre, la glycémie va augmenter, l’osmolarité va augmenter.
=> pas assez d’eau dans le plasma.
L’organisme va donc corriger ce déséquilibre en transférant de l’eau de la cellule vers le plasma = déshydratation cellulaire = hyponatrémie => « fausse hyponatrémie » (nous le reverrons à la fin de cet épisode).
Donc, quand on dit que l’hyponatrémie est forcément le reflet d’une hypo-osmolarité, attention, c’est en excluant la glycémie du système… hors, les causes d’hyperglycémie sont fréquentes (diabète décompensé) donc toujours se dire face à une hyponatrémie 👉🏻 la glycémie est-elle normale ?
En effet, si la glycémie est normale, vous pourrez raisonner en disant hyponatrémie = hypo-osmolarité.
Au contraire si la glycémie est élevée, alors vous devrez dire simplement que l’hyponatrémie est le reflet d’une hyperglycémie.
Donc ceci nous amène au 4ème postulat : « Toute hyponatrémie est un diabète décompensé jusqu’à preuve du contraire »
Pourquoi la dysnatrémie est dangereuse sur le plan neurologique ?
Et bien c’est simple.
Vous avez compris que toute variation de natrémie dans le système se traduira par des mouvements d’eau cellulaire.
Hors, les neurones sont très très sensibles à ces variations et de plus, la boîte crânienne est inextensible donc un gonflement des cellules va engendrer un effet de masse avec risque d’engagement à l’extrême.
La présence :
- de signes neurologiques tels que la confusion,
- une hyponatrémie <125 ou
- une hyponatrémie d'installation rapide
sont des signes de gravité de l'hyponatrémie.
Revenons à la natrémie et à une hormone régulatrice : l’ADH (hormone anti diurétique):
La natrémie (et l’osmolarité) sont donc finement régulées afin d’éviter cela et on considère que l’osmolarité plasmatique normale varie entre 280 et 290 milliosmoles/L et la natrémie normale varie entre 135 et 145 mmol/L.
L’ADH (hormone anti-diurétique ou vasopressine) est le principal régulateur de la natrémie.
Quand la natrémie augmente, la sécrétion hypothalamique d’ADH augmente ce qui entraîne une concentration des urines et permet de garder l’eau dans l’organisme.
A l’inverse, quand la natrémie diminue, la sécrétion d ‘ADH diminue ce qui entraîne une dilution des urines et permet d’éliminer l’excès d’eau dans les urines.
L’osmolarité urinaire s’adapte donc au stock d’eau de l’organisme.
Lorsque l’organisme est en manque d’eau, par exemple lors d’une marche prolongée sous un soleil intense ☀️☀️☀️(sécrétion d’ADH maximale), les urines sont très concentrées (osmolarité urinaire pouvant monter jusque 800 mosmol/l) pour éviter un déficit en eau et donc une hypernatrémie.
A l’inverse, en cas de prise très abondante de boissons par exemple lorsque vous allez à la fête de la bière à Munich 🍺🍺🍺(sécrétion d’ADH effondrée), les urines sont très diluées (osmolarité urinaire pouvant descendre jusque 100 mosmol/l) afin d’éliminer l’excès d’eau et éviter une hyponatrémie.
NB 1: en cas d’hypernatrémie, 2 mécanismes de « défense » agissent conjointement pour garder l’eau dans le corps => sécrétion maximale d’ADH (et donc concentration maximale des urines) + la soif (stimulant la prise de boissons). À l’inverse, en cas d’hyponatrémie, seul 1 mécanisme de « défense » nous protège => l’inhibition de la sécrétion d’ADH (et donc dilution maximale des urines). Cela explique que l’hyponatrémie soit beaucoup plus fréquente que l’hypernatrémie.
NB 2 : hormis la hausse de la natrémie, de nombreux stimuli peuvent entraîner une sécrétion d’ADH au niveau hypothalamique :
- hypovolémie : en effet l’ADH ayant un effet vasoconstricteur (« vasopressine »), elle est stimulée par l’hypovolémie comme le système rénine/aldostérone, les catécholamines…
-les émotions : nausées, peur, douleur => stimulation du système limbique et de l’hypothalamus avec relargage d’ADH.
La fausse hyponatrémie :
Vous pourrez parfois être confrontés à une « fausse » hyponatrémie => situation où un soluté est osmotiquement actif dans le plasma et augmente l’osmolarité plasmatique, entraînant ainsi un flux d’eau de la cellule vers le plasma, ce qui, au final, dilue le sodium et crée une « fausse » hyponatrémie. (C’est la cas de l’hyperglycémie). En réalité, l’osmolarité plasmatique étant très élevée, les cellules seront collabées comme dans le cas d’une hypernatrémie et la prise en charge thérapeutique sera donc celle d’une hypernatrémie, le but étant de faire baisser l’osmolarité plasmatique en apportant de l’eau.
Exemple : décompensation diabétique majeure avec hyperglycémie importante => le glucose crée une hyperosmolarité plasmatique avec sortie d’eau des cellules, ce qui entraîne une « fausse » hyponatrémie.
Afin de ne pas se faire piéger par cette situation, il est recommandé de confirmer l’hyponatrémie par un dosage de l’osmolarité plasmatique MESURÉE (au laboratoire, par congélation du plasma, le point de congélation du plasma permettant de déduire la vraie osmolarité plasmatique). 👍 ou de mesurer approximativement la natrémie corrigée par cette deuxième formule :
Nac = Nam + 0,3 (Glycémie - 5,5) (mmol/L)
ou en grammes/L :
Nac = Nam + 1,6 (Glycémie -1) (g/L)
Voilà, on arrive au bout de ce 1er épisode sur la physiopathologie, vous voyez il faut retenir 4 postulats et 2 équations avec cela vous trouverez toutes les causes de dysnatrémie et surtout vous saurez comment les corriger ! 👍
Pour résumer, retenons :
4 POSTULATS :
- La natrémie est le reflet de l’osmolarité plasmatique qui régule les mouvements d’eau de part et d’autre des cellules,
- L’osmolarité de part et d’autre des cellules doit être égale,
- Les modifications d’osmolarité à travers les cellules se font par des mouvements d’eau et non d’osmoles,
- Toute hyponatrémie est un diabète décompensé jusqu’à preuve du contraire.
2 EQUATIONS :
- Osmolarité = 2*{Natrémie} + glycémie
- Na corrigée = Nam + 0,3 (Glycémie - 5,5) ( en mmol/L)
Installez-vous confortablement ☕️ ☕️ ☕️
Attaquons maintenant la 2ème partie de cet épisode sur la physiologie de la natrémie en cliquant sur la vidéo du Dr Savenkoff, Néphrologue qui vous résume les éléments clés à retenir 😉
Rendez-vous après la vidéo pour les QCM ! Bonne projection 🎥 😉
- Pas le temps pour la vidéo ?
- Ce n’est pas grave, faites une pause, vous pourrez reprendre plus tard nous mesurons le temps de formation, chacun son rythme !