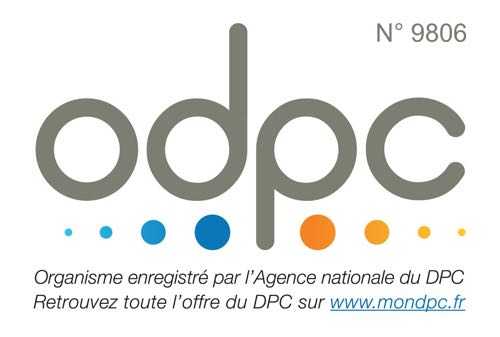Si vous êtes déjà inscrit, tapez juste votre adresse email puis votre mot de passe
Épisode 1 : Le cancer du sein est-il un bon exemple de dépistage ? Notions générales sur la maladie
La phrase du jour :
« Le dépistage du cancer du sein diminue la mortalité du cancer du sein »
Pour pouvoir convaincre les femmes de l’intérêt de faire du dépistage, il faut qu’elles connaissent un minimum la réalité de la maladie, mais aussi qu’elles et leurs médecins aient une connaissance de base tant anatomique, que physiologique pour appréhender des lésions tant bénignes que cancéreuses.
I) Epidémiologie
Le cancer du sein est une préoccupation majeure, représentant, chez les femmes en France, le cancer le plus fréquent (un tiers des nouveaux cas de cancer) C’est également la première cause de mortalité par cancer, non pas en raison de son agressivité mais de son incidence.
1-1) Incidence
En 2018, 58 459 nouveaux cas de cancer du sein ont été recensés, avec 12 146 décès estimés.
Le taux d’incidence n’a pas cessé d’augmenter en France, comme dans les autres pays développés : entre 1990 et 2018, le nombre annuel de nouveaux cas de cancer du sein chez la femme a presque doublé. On note par contre une diminution progressive du taux de mortalité.
S’il existe quelques disparités par région en France, l’incidence globale positionne la France au 8eme rang des pays européens.


En France, sont diagnostiqués en pourcentage :
- 2/3 de nouveaux cas, entre 50 et 74 ans (33 805 cas en 2018)
- 1/3 avant 50 ans (9170 entre 40 et 49 ans en 2018) et après 75 ans (7880 entre 75 et 84 ans en 2018)
Cela permet de se poser la question de l’optimisation des modalités de dépistage, ce d’autant que celles-ci s’avèrent variables en seuil en fonction des pays. (Cf. épisode 2)
Pendant de nombreuses années, il a été affirmé que ce cancer ne touchait que les pays occidentalisés et industrialisés. Quand on regarde les données récentes, on constate que l’incidence augmente quasiment partout dans le monde.
Le cancer du sein est devenu la première cause de cancer mondiale, dépassant le cancer du poumon.(chiffres 2020)
Le cancer du sein représente, chez la femme, un quart des nouveaux cas de cancers, au niveau mondial. Si les 2/3 surviennent chez des femmes de 50 ans et plus, en majorité dans les pays économiquement développés, la femme jeune (15-49 ans) continue à payer un lourd tribut dans les pays en voie de développement.

A partir de ce site, il est possible de télécharger de nombreuses données actualisées (2020), avec des cartes par pays et par localisation cancéreuse. 💎💎💎

Exemples 👇


1-2) Mortalité
Si les courbes d’incidence ne cessent de croitre, les courbes de mortalité décroissent de façon quasi homogènes à travers le monde. Les taux de mortalité correspondent à des cancers du sein découverts et traités plusieurs années au préalable, dont les caractéristiques étaient différentes de celles des cancers dépistés actuellement.
En Europe, la mortalité par cancer du sein diminue régulièrement, tout en restant la première cause de mortalité par cancer. La baisse est liée aux deux facteurs dépistage / progrès des thérapeutiques.
La mortalité par cancer du sein diminue en Europe, celle-ci étant plus marquée dans la population ciblée par le dépistage organisé (16,4 % chez les femmes âgées de 50 à 69 ans).
La réduction de la mortalité par cancer du sein entre les femmes participant au dépistage organisé et celles n'y participant pas varie de 33 versus 43 % en Europe du Nord, 43 % versus 45 % en Europe du Sud et 12 % à 58 % en Europe de l'Ouest (données actualisées en 2020).
II) Facteurs de risque :
Il est difficile de déterminer des facteurs de risque hautement significatifs pour la survenue d’un cancer du sein, hormis le sexe et l’âge, paramètres non modifiables. Le facteur âge, qui est majeur, rend bien compte de l’augmentation de l’incidence, dans les pays ayant un pourcentage grandissant de population âgée, voire très âgée. ( 2019 Estimations nationales tumeurs solides)

De longue date, les paramètres de vie hormonale ont été incriminés dans les facteurs de risque : âge aux premières règles, âge à la première grossesse, allaitement en nombre de mois, nombre d’enfants, âge de la ménopause, traitements hormonaux (contraception, traitement de la ménopause) mais aucun lien de causalité franc n'a été mis en évidence à ce jour.
On évoque aussi l’alcool à forte dose, les graisses et les perturbateurs endocriniens.
Il faut ajouter à cette liste le concept de densité mammaire, très débattu de longue date, qui dans la majorité des modèles de prédiction est pris en considération, mais non retenu en France. Il est évident qu’une densité mammaire élevée ne favorise en rien la détection d’anomalies mammographiques, Par ailleurs, elle tend à diminuer au cours de la vie.
Enfin, des irradiations dans l’enfance ou lors de maladies traitées par radiothérapie tel la maladie de Hodgkin constituent une augmentation du risque et font considérer ces femmes à risque élevé. De même, des antécédents de biopsie mammaire de lésions bénignes ou de néoplasie in situ sont à considérer dans le risque mammaire augmenté.
Les antécédents familiaux, que ce soit du côté maternel ou paternel, sont par contre beaucoup plus parlants, et ce, notamment s’ils sont nombreux et apparus chez des personnes plus jeunes. Ils sont majeurs si une mutation génétique est mise en évidence, qu’elle soit sur le chromosome 17 (BRCA1) ou sur le chromosome 13 (BRCA2). Les critères de demande d’une consultation génétique sont bien établis et la majorité des scores utilisent celui de EISINGER, (pas de panique, on reparlera de ce score dans l'épisode 3).
Plus de la moitié des patientes présentant des cancers du sein n’ont aucun facteur de risque avéré et comprennent d’autant plus mal qu’ils soient mis en avant dans une politique de prévention.
La part de responsabilité génétique n’excède pas les 8 à 10% de l’ensemble des cancers du sein.
C’est le pari des modèles de prédiction qui se multiplient : l’enjeu n’est pas tant de déterminer si une femme fera ou non un cancer du sein dans sa vie que de déterminer lesquels seront agressifs.
L’INCa a établi une fiche technique utile et téléchargeable aisément, permettant de mieux identifier les risques reconnus comme plus importants.
L’HAS avait également réuni un groupe de travail sur cette question, menant aux mêmes identifications des notions de haut risque.

III) Histoire naturelle et pronostic
Ces cancers ont une histoire naturelle remarquable par une phase de latence infra clinique longue de plusieurs années, qui permet idéalement un diagnostic anticipé.
💎💎💎💎Cette phase préclinique peut être détectée par le dépistage mammographique. 💎💎💎💎
A ce stade, les lésions sont totalement guérissables. La mammographie permet le diagnostic de lésions infra millimétriques (micro calcifications) et remplissant ainsi les conditions OMS de dépistage à grande échelle.

IV) Evolution de la prise en charge des cancers du sein : traitement adapté, personnalisé
Pour plus de simplicité, nous n’évoquerons ici que la situation initiale au diagnostic, sans métastases.
L’essor du dépistage a permis, en quelques décennies, de mettre en évidence des tumeurs de plus en plus petites, à un stade plus précoce.
De plus en plus souvent, le traitement chirurgical pourra être potentiellement précédé d’un traitement médical appelé « néo » adjuvant :
- soit de la chimiothérapie (plus ou moins thérapie ciblée),
- soit de l’hormonothérapie (souvent chez les femmes âgées).
Ainsi, la place et le rôle des réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP) se sont majorés, permettant l’élaboration d’un Plan Personnalisé de Soins (PPS), qui modulera l’ordre successif des traitements, la chirurgie n’étant plus systématiquement le premier temps thérapeutique.
Ces paramètres sont :
- le type de cancer (invasif ou non),
- son origine (canalaire ou lobulaire),
- son grade SBR et son indice de prolifération exprimé par le Ki 67,
- l’existence ou non de récepteurs hormonaux, (RE estrogènes/ RP progestérone),
- l’existence d’une surexpression d’une protéine de la famille des récepteurs des facteurs de croissance, appelée HER2 ou cerb B2, (présente dans environ 20% des cancers du sein, et imposant un traitement de chimiothérapie avec Thérapie ciblée.)
Ces différents facteurs, ainsi que l’âge de la patiente et ses antécédents médicaux, vont permettre de proposer un schéma de traitement le plus adapté possible.
La chimiothérapie sera utile dès que la tumeur présente un degré important de prolifération pour détruire les cellules cancéreuses, elle sera associée à des thérapies ciblées si nécessaire (surexpression de HER2), agissant sur certains récepteurs en bloquant la progression tumorale. Ces thérapies nécessitent d’être associées à une chimiothérapie, par voie parentérale, en général par l’intermédiaire d’une chambre implantable.
L’hormonothérapie n’agira que s’il existe des récepteurs hormonaux (RH), définissant la tumeur comme hormonosensible. Elle ne sera donc prescrite que lorsque les récepteurs hormonaux sont présents, ce qui est le cas d’environ 75-80% des tumeurs. Elle a pour but de supprimer l’action stimulante sur la tumeur des hormones féminines (estrogènes/progestérone).
Des documents à visée des patientes et de leur proches sont disponibles et téléchargeables sur le site de l’Institut National de Cancérologie (INCa), rédigés et actualisés à leur attention.
Un super site internet est à voir ici : vraiment très complet et adapté aux patientes avec flyer, FAQ, podcast ... Nous vous conseillons de le placer dans vos favoris sur votre navigateur web ! site de l'INCa +++
Ces traitements médicaux ont trois types d’objectif, et peuvent être utilisés ensemble ou successivement :
- Réduire ou supprimer la tumeur initiale : traitement néo adjuvant précédant le traitement loco-régional associant souvent chirurgie et radiothérapie
- Réduire le risque de récidive après traitement loco-régional : traitement médical adjuvant hormonothérapie ou chimiothérapie adjuvante
- Ralentir voire stopper le développement des métastases ou de la récidive locale : traitement métastatique palliatif.
V)Importance du suivi ultérieur 👉🏻 l'après cancer
Ce parcours de soins peut durer selon les modalités de quelques mois à plus d’une année. Même si de plus en plus on incite les patientes à demeurer actives (certaines travaillent pendant les traitements) , il n’empêche que plus que jamais la période de l’APRES est partie intégrante de la prise en charge optimisée. Bien évidemment, elle est en relation étroite avec le degré de communication entre médecins et spécialistes et entre médecin traitant et patiente. Il reste beaucoup de travail pour l’optimiser et le rendre fluide et satisfaisant. Compte tenu du haut degré de rémissions voire de guérison, c’est un pari majeur pour l’avenir, qui nous concernent tous.
Voilà la partie texte de cet épisode 1 est terminée.
Installez-vous confortablement ☕️ ☕️ ☕️
- Attaquons maintenant la 2ème partie de ce épisode sur le dépistage du cancer du sein en cliquant sur la vidéo du Dr Lesur, Onco-sénologue à Nancy qui vous résume tout ce qu’il faut savoir sur le sujet 😉
Rendez-vous après la vidéo pour les QCM ! - Pas le temps pour la vidéo ?
C’est pas grave, faites une pause, vous pourrez reprendre plus tard nous mesurons le temps de formation, chacun son rythme !