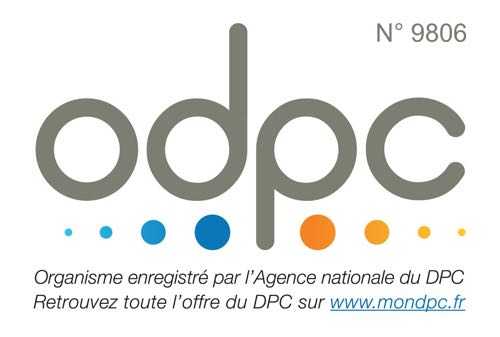Si vous êtes déjà inscrit, tapez juste votre adresse email puis votre mot de passe
Épisode 2 : Comment évaluer le retentissement des addictions ?
La phrase du jour :
« L'évaluation des addictions doit être globale »
L'évaluation de l'addiction est une étape capitale et parfois difficile en médecine générale car chronophage et multiple.
Nous allons essayer de vous donner les clés et les principaux points à évaluer en soins primaires face à un malade souffrant d'addiction.
C'est parti 🚀🚀🚀
Tout d'abord, comme vous l'avez vu dans l'épisode 1, il faut être capable de REPÉRER et ABORDER les malades.
Ensuite, il faut savoir différencier usage à risque, usage nocif et addiction.
Enfin, il faut savoir évaluer le malade. Cette évaluation doit être GLOBALE c'est à dire : BIO PSYCHO SOCIALE.
💎💎💎💎 EVALUATION = GLOBALE = BIO PSYCHO SOCIALE 💎💎💎💎
Si l'addiction proprement dite est rarement un motif de consultation, ses dommages le sont par contre fréquemment et doivent nous alerter sur la présence d'un trouble lié à l'usage.
Cette évaluation globale nécessite des compétences particulières en communication pour établir une relation de confiance avec le malade.
On pourrait résumer cette compétence en 3 mots : empathie sans jugement.
Retenons bien les 6 mots clefs 👇
💎 REPÉRER => ABORDER => ÉVALUER => MOTIVER => TRAITER => ACCOMPAGNER 💎
Nous allons maintenant aborder l'évaluation globale des 2 substances psychoactives les plus fréquentes et voir ensemble les retentissements à rechercher dans l'évaluation globale.
1) LE TABAC
Comme toujours, il faut évaluer :
- la sévérité de l'addiction,
- les complications de l'addiction.
Il ne faut pas penser que ces 2 champs d'investigation sont synonymes.
Pour le tabagisme, on proposera :
- Évaluation de la consommation,
- Évaluation de la sévérité de l'addiction,
- Recherche de co-addictions,
- Évaluer la motivation à l'arrêt,
- Évaluer les comorbidités,
- Rechercher les complications du tabagisme.
1) Pour évaluer la consommation, on pourra demander l'âge de début, la durée en année, la quantité en paquets-années, les tentatives d'arrêt antérieures.
🧨 le risque tabagique augmente à la puissance 2 avec la quantité et augmente à la puissance 4 avec la durée d'exposition 🧨
2) Pour évaluer la dépendance, le test de Fagerström est souhaitable. Il ne faut pas oublier aussi de rechercher des signes de sevrage et de craving.
Sd de sevrage nicotinique =
- Irritabilité, frustration, anxiété, colère,
- troubles du sommeil,
- bradycardie,
- augmentation de l'appétit et/ou prise de poids.
Signes de craving =
- pulsion à consommer du tabac 👉🏻 bon reflet de la dépendance psychologique et comportementale.
3) Rechercher des co-addictions :
- Alcool 👉🏻 saviez-vous que la consommation d'alcool sans addiction est un FdR de rechute du tabagisme ?
- Cannabis 👉🏻 empêche l'arrêt du tabac 👉🏻 doit être sevré.
- Autres substances
4) Évaluer la motivation à l'arrêt :
Le patient souhaite-t-il un sevrage ou une réduction de la consommation ou pas de modification de sa consommation ?
5) Évaluer les comorbidités :
Pathologies cardio-vasculaires et respiratoires (Spirométrie => BPCO ? si vous voulez débuter en spirométrie rdv sur notre formation avec le Pr Poussel ici 👇😉:
Pathologies psychiatriques notamment l'anxio-dépression qui augmente le risque de fumer et diminue les chances de succès de sevrage tabagique.
Le tabagisme est très fréquent dans les troubles psychiatriques (80 % dans la schizophrénie, 60% dans la bipolarité).
6) Les complications du tabagisme :
- Cancer 👉🏻 Excellent site de l'INCa,
- Pulmonaires: BPCO, asthme, fibrose pulmonaire idiopathique,
- Maladies CV 👉🏻 1ère cause de mortalité CV évitable,
- Autres pathologies : digestive, ophtalmo, dermato, hémato, osseuse, sensorielle, gynéco (Baisse de la fertilité).
2) L'ALCOOL :
Comme toujours, il faut évaluer :
- la sévérité de l'addiction,
- les complications de l'addiction.
Il ne faut pas penser que ces 2 champs d'investigation sont synonymes.
1) Evaluer la sévérité de l'addiction à l'alcool :
Il est utile de mesurer :
- les consommations moyennes d’alcool,
- et la fréquence des jours de forte consommation (égale ou supérieure à six verres-standard).
Ces deux paramètres ont montré une relation de proportionnalité avec les principaux risques médicaux liés à l’alcool.
Rappel : 💎 Quantité (en g) = volume (L) x degré (%) x 8 (densité) 💎

Il existe des échelles de sévérité de la dépendance, dont les versions françaises sont principalement utilisées en recherche, sans véritable intérêt en pratique clinique (comme l’Alcohol Dependence Scale).
Plus simplement, la sévérité d’un mésusage de l’alcool peut se mesurer :
- par le compte du nombre de critères diagnostiques du trouble de l’usage du DSM-5,
- ou par le questionnaire AUDIT-C +++ 👇

Un score égal ou > à 10 chez la femme ou chez l’homme doit faire évoquer une dépendance à l’alcool.
L’histoire du mésusage devra être précisée :
- ancienneté du trouble,
- périodes d’amélioration, voire d’abstinence,
- les différentes interventions thérapeutiques et leur efficacité doivent également être recueillies.
La présence de troubles d’usage d’autres substances, ou d’addictions comportementales, doit être recherchée systématiquement, tout particulièrement le tabac, le cannabis et le jeu pathologique.
2) La recherche des complications :
Neuropsychologiques :
Des troubles neuropsychologiques induits par l’alcool peuvent affecter la mémoire, les fonctions exécutives telles que l’inhibition, la flexibilité mentale, la planification ou les capacités mnésiques. À l’extrême, on peut craindre des formes sévères aigües telles que l’encéphalopathie de Gayet-Wernicke ou chroniques telles que le syndrome de Korsakoff. Le dépistage des troubles neuropsychologiques peut être effectué par le clinicien non spécialisé en neuropsychologie à l’aide du test d’évaluation cognitive de Montréal (MoCA) ; cette évaluation devant être réalisée en dehors d’une consommation d’alcool et après arrêt des benzodiazépines.
En cas de suspicion d’un trouble neuropsychologique, il est recommandé que l’évaluation neuropsychologique soit réalisée par des professionnels spécialisés.
D’autres complications centrales (par exemple une atteinte cérébelleuse) ou périphériques (polynévrites) doivent être recherchées par l’examen clinique. À l’exception de l’encéphalopathie de Gayet-Wernicke, l’imagerie cérébrale structurelle (ou anatomique) a une faible sensibilité pour repérer les atteintes cognitives liées à l’alcool; elle est surtout utile pour éliminer un diagnostic différentiel.
Nutritionnelles :
Les carences nutritionnelles sont fréquemment associées au mésusage de l’alcool. Des troubles neurologiques ou neuropsychologiques doivent conduire à l’exploration d’une carence nutritionnelle, notamment en vitamine B1. Les critères de dénutrition protéino-énergétiques sont évalués selon les critères de la Haute Autorité de Santé :
- indice de masse corporelle,
- albuminémie, pré-albuminémie,
- évaluation de la perte de poids.
En cas de signe clinique d’encéphalopathie de Gayet-Wernicke (même pour un tableau incomplet), le sujet doit être hospitalisé en urgence et bénéficier d’un traitement par thiamine en injection intraveineuse.
Hépatiques :
La maladie alcoolique du foie (MAF) est une complication fréquente de la consommation excessive d’alcool. Elle est cliniquement asymptomatique pendant des années, et comprend plusieurs stades lésionnels, diversement associés.
La stéatose (90 % des buveurs de plus de six unités par jour) est asymptomatique et réversible; la stéatohépatite (10 à 35 % des patients hospitalisés pour alcoolisme) est le plus souvent asymptomatique en l’absence de cirrhose.
La cirrhose (souvent irréversible) a une prévalence qui est estimée à 10-20 % chez les buveurs de plus de six unités par jour. La cirrhose peut être asymptomatique (compensée) ou associée à des complications (décompensée), les plus fréquentes étant l’ascite, l’hémorragie digestive, l’encéphalopathie et l’infection.
Le carcinome hépatocellulaire (CHC) survient le plus souvent sur une cirrhose compensée, avec une longue phase asymptomatique.
Les aspects diagnostiques de ces pathologies font l’objet d’un consensus international.
Le diagnostic de MAF repose sur l’association de :
- un mésusage de l’alcool,
- une biologie évocatrice (cytolyse modérée, de 2 à 5 fois la limite supérieure de la normale, prédominant sur les ASAT, et augmentation marquée des γGT),
- l’élimination d’autres causes de maladie hépatique.
Chez un patient ayant une consommation alcoolique actuelle, un bilan hépatique normal permet d’exclure une MAF significative (mais pas sa survenue dans le futur).
L'évaluation biologique a une place importante mais, attention, le bilan biologique n'a aucune place dans le dépistage d'un mésusage 🧨🧨🧨
Des examens biologiques permettant de rechercher des complications somatiques de la consommation d’alcool (numération formule sanguine, TP, ASAT, ALAT, γGT) doivent être effectués au début de chaque nouvelle séquence de soins primaires ou en milieu spécialisé, et au moins tous les ans lors d’un suivi ambulatoire. En cas d’anomalies, le bilan est complété à la recherche d’une cirrhose compensée.
Évaluation psychiatrique :
Plus d’un tiers des sujets avec un mésusage de l’alcool présentent au cours de leur vie une comorbidité psychiatrique, en particulier une dépression, un trouble anxieux, un risque suicidaire accru.
À l’inverse, la comorbidité psychiatrique est associée à un risque de mésusage de l’alcool plus sévère et le mésusage de l’alcool aggrave la symptomatologie psychiatrique. La co-occurrence diminue l’observance thérapeutique.
Pour éliminer la responsabilité de la consommation excessive d’alcool dans l’expression des symptômes psychiatriques, une période d’abstinence (en cas de trouble de l’usage sévère), ou de consommation à faible risque (en cas de mésusage d’intensité modérée) au moins égale à deux semaines, est recommandée avant d’éliminer un trouble psychiatrique lié à l’usage de substance ou de mettre en place un traitement pharmacologique spécifique.
Un bilan approfondi réalisé par un psychiatre peut être nécessaire, qui envisagera éventuellement une intervention thérapeutique coordonnée avec le professionnel de santé prenant en charge le mésusage.
Compte tenu de la forte prévalence du risque suicidaire chez les patients souffrant d’un mésusage de l’alcool, ce risque doit faire l’objet d’une évaluation systématique quels que soient le niveau et la spécialisation de la prise en charge initiale.
Évaluation sociale :
L’évaluation sociale d’un mésusage de l’alcool n’est pas différente de celle menée dans le cadre d’une autre pathologie chronique. Néanmoins, la recherche d’éléments orientant vers des facteurs de vulnérabilité, l’étude des parcours éducatif, professionnel et familial font partie de l’examen initial.
L'amélioration des conditions de vie est un élément important pour l’efficacité de la prise en charge.
Le statut du sujet doit être renseigné au regard de la stabilité des liens sociaux qui seront appréciés par :
- le mode de vie seul ou accompagné, les relations familiales stables ou non, et les conditions d’hébergement : domicile, conditions précaires...,
- les valeurs véhiculées par l’entourage social concernant la consommation d’alcool : entourage fortement consommateur, ou au contraire valorisant la modération, voire l’abstinence,
- les qualifications, les aptitudes et activités professionnelles : emploi stable ou précaire, invalidité, allocation adulte handicapé...,
- la protection sociale (obligatoire et facultative), éventuellement l’inscription en affection de longue durée, ALD 30, si le recours fréquent aux soins le justifie,
- la reconnaissance d’un handicap physique, cognitif ou psychiatrique (via la maison départementale des personnes handicapées) ou d'un statut de majeur protégé (curatelle ou tutelle) peuvent être justifiés.
Enfin, il faudra évaluer la situation judiciaire du sujet.
Voilà la partie texte de cet épisode 2 est terminée.
Installez-vous confortablement ☕️ ☕️ ☕️ et visionnez la vidéo du Pr François PAILLE, médecin addictologue à Nancy, président d'honneur de la société française d'addictologie, qui vous explique tout cela en détail en faisant un focus sur l'alcool.
Bonne projection 😉
Rendez-vous après la vidéo pour les QCM !
Pas le temps pour la vidéo ?
Ce n’est pas grave, faites une pause, vous pourrez reprendre plus tard nous mesurons le temps de formation, chacun son rythme